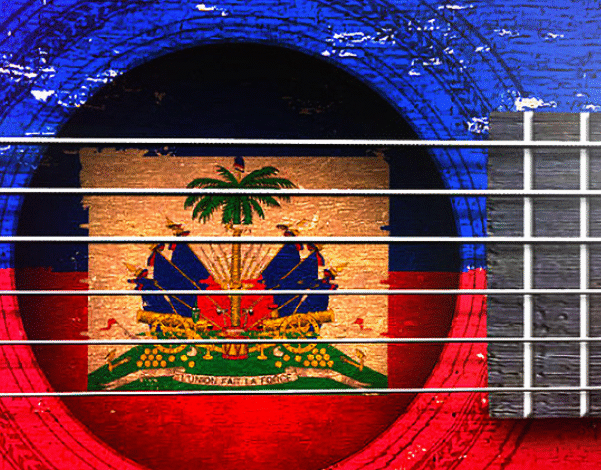
Tandis que les projecteurs mondiaux s’éloignent peu à peu d’Haïti, l’industrie musicale nationale continue de se débattre dans l’ombre, frappée de plein fouet par la crise socio-politique et économique chronique que traverse le pays. Entre instabilité gouvernementale, précarité économique et manque de soutien structurel, la musique haïtienne lutte pour sa survie dans un environnement de plus en plus hostile.
Dans un contexte où les pouvoirs publics peinent à assurer leurs fonctions essentielles, le Ministère de la Culture reste largement sous-financé, limitant ainsi toute action de soutien durable au secteur artistique. La vie culturelle, pourtant historiquement dynamique en Haïti, se trouve réduite à une résistance artisanale portée par des individus passionnés mais isolés.
Une économie exsangue, un public appauvri
La crise économique qui perdure depuis plus de deux décennies n’épargne personne. Entre un PIB en stagnation, une inflation galopante, et une monnaie nationale en chute libre, le pouvoir d’achat des Haïtiens fond comme neige au soleil. Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, freinant toute possibilité de développement d’une économie du divertissement, et limitant l’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), essentielles aujourd’hui à la diffusion musicale.
Malgré ce contexte morose, la scène musicale haïtienne reste d’une richesse impressionnante, portée par une diversité de genres. Si le konpa demeure le pilier commercial de l’industrie, la dernière décennie a vu émerger une scène alternative bouillonnante, reflet d’une jeunesse créative et connectée à l’international.
Une chaîne de production déséquilibrée et informelle
Selon les professionnels interrogés, la chaîne de valeur musicale haïtienne souffre d’un déséquilibre profond. La création artistique y est surreprésentée, au détriment des maillons de production et de diffusion, essentiels à la transformation des œuvres en produits culturels accessibles et rentables.
Le secteur reste fortement centralisé dans la capitale, tandis que les offres de services tendent à se délocaliser vers les pays de la diaspora. La majorité des acteurs sont des travailleurs indépendants non encadrés, fonctionnant dans une économie informelle et souvent auto-producteurs, faute d’accès au crédit ou à un accompagnement administratif.
Les revenus générés par les prestations live, principales sources de revenus du secteur, sont faibles et ne suffisent pas à couvrir les frais de production. Les sponsors, rares et limités par la fragilité économique du pays, ne peuvent pallier l’absence d’un véritable écosystème de financement.
Droits d’auteur : un manque à gagner colossal
Autre frein majeur : l’absence d’un système efficace de gestion des droits d’auteur, privant les artistes d’une source de revenus essentielle. Dans cet environnement précaire, rares sont ceux qui parviennent à vivre décemment de leur art.
Un espoir venu d’ailleurs : diaspora et investissements étrangers
Quelques entreprises étrangères ont récemment tenté l’aventure haïtienne, en soutenant la production de certains talents locaux. De même, la diaspora haïtienne joue un rôle crucial, en offrant visibilité, opportunités de diffusion et marchés rémunérateurs. Toutefois, les artistes désireux d’exporter leur musique se heurtent à de multiples barrières : difficultés d’obtention de visas, coûts élevés de transport, et manque de support institutionnel pour accompagner les projets à l’international.
Un appareil d’État morcelé et inopérant
En dépit de la présence de plusieurs organismes publics liés au secteur culturel, l’État haïtien ne dispose ni d’une législation adaptée, ni d’une politique claire et coordonnée pour soutenir la filière musicale. Pire encore, plus d’une douzaine d’institutions nationales et internationales interviennent dans le secteur, souvent sans coordination ni synergie.
Des recommandations restées lettre morte

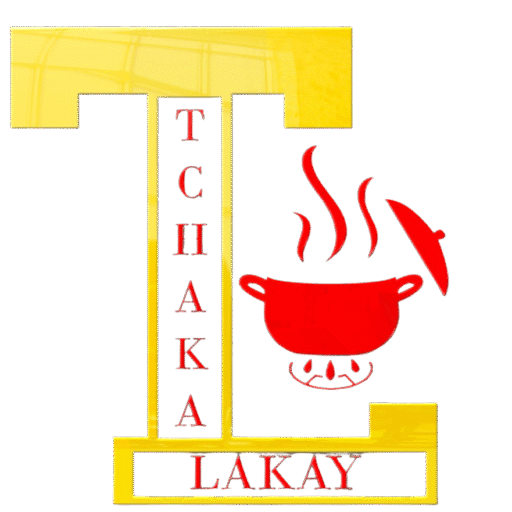
Il est tellement beau de mettre en valeur la culture haïtienne ❤️❤️